Les mesures de transparence et de confiance contribuent à prévenir les conflits en fournissant aux États des outils pratiques pour échanger des informations, instaurer la confiance et réduire les tensions au niveau bilatéral, régional ou mondial. Ces mesures contribuent à réduire les accumulations d'armes excessives ou déstabilisantes et à prévenir les perceptions erronées, les erreurs de calcul et l'escalade entre les États. En fin de compte, elles contribuent à créer des conditions favorables à la réalisation du Programme de développement durable à l'horizon 2030.
Mandaté par l'Assemblée générale, le Bureau des affaires de désarmement des Nations unies (ODA) a élaboré un ensemble d'instruments de transparence et de renforcement de la confiance, notamment le rapport des Nations unies sur les dépenses militaires, le registre des Nations unies pour les armes classiques et le référentiel des Nations unies sur les mesures de confiance militaires (CBM). En outre, par le biais de l'action 23 de l'Agenda pour le désarmement du Secrétaire général, " Assurer notre avenir commun", l' APD s'efforce de faire progresser le dialogue régional sur les mesures de confiance militaires.
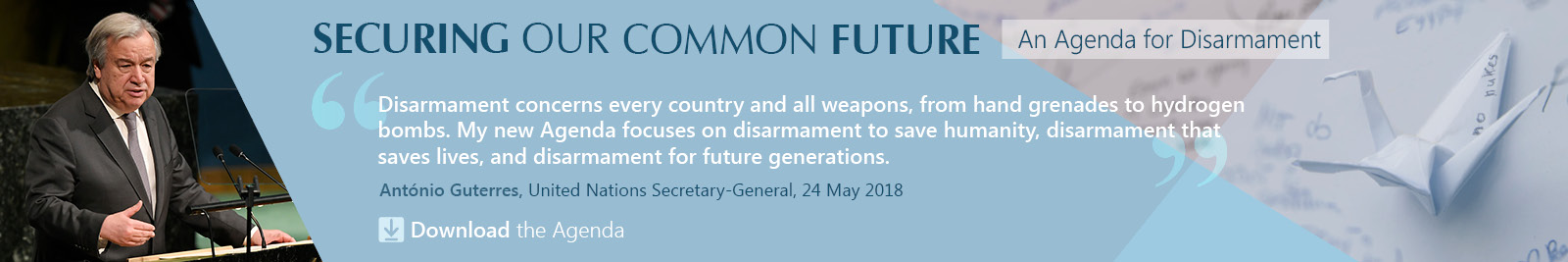
Mesures de confiance militaires
Les mesures de confiance militaires (MDC) constituent un outil important dans la boîte à outils de la prévention et de la résolution des conflits. Il s'agit de toute procédure unilatérale, bilatérale ou multilatérale impliquant des organisations nationales de défense et pouvant inclure, entre autres, des mesures de communication et de coordination, des mesures d'observation et de vérification, des mesures de coopération et d'intégration, des mesures de contrainte militaire et des mesures de formation et d'entraînement.
À court terme, les mesures de confiance visent à corriger les perceptions potentiellement inexactes des motivations militaro-stratégiques entre deux ou plusieurs États, à éviter les malentendus sur les actions et les politiques militaires et à favoriser la coopération et l'interdépendance en matière de sécurité. Au fil du temps, ces mesures contribuent à la prévention des conflits en stabilisant les relations régionales et bilatérales, en transformant les idées sur les exigences nationales en matière de sécurité et en encourageant les mesures visant à identifier conjointement les besoins communs en matière de sécurité. En renforçant la confiance et en améliorant la stabilité militaire, les mesures de confiance militaires peuvent faciliter la limitation des armements et le désarmement et promouvoir des conditions propices au développement durable.
Dans une résolution biennale, l'Assemblée générale prie le Secrétaire général d'engager le dialogue avec les États membres et les organisations régionales intéressés sur l'élaboration et la promotion des mesures de confiance militaires, en renforçant la compréhension de ce sujet et en fournissant des conseils et une assistance sur le fond et la procédure. L'Assemblée générale a également demandé la création d'un répertoire des mesures de confiance militaires, contenant les mesures les plus testées et les plus fiables.
Dans son rapport de 2017, la Commission du désarmement de l'ONU a recommandé aux États d'envisager une série de mesures de confiance pratiques dans le domaine des armes classiques, notamment l'établissement de voies de communication directes, la désignation réciproque de points de contact, l'échange périodique d'informations et la notification des mouvements de troupes et des manœuvres militaires, ainsi que des mesures de contrainte militaires.
L'importance des mesures de confiance pour renforcer la confiance entre les États membres et le rôle que les organisations et les cadres régionaux peuvent jouer à cet égard sont également reconnus dans la note de synthèse du Secrétaire général sur le nouvel agenda pour la paix.
En outre, par le biais de l'action 23 de l'Agenda pour le désarmement du Secrétaire général, " Assurer notre avenir commun", l' APD s'efforce de faire progresser le dialogue régional sur les mesures de confiance militaires.
Référentiel des mesures de confiance militaires
Ce répertoire mondial évolutif de mesures de confiance (MDC), collectées dans toutes les régions du monde, peut aider tout couple ou groupe d'États à élaborer ses propres MDC militaires.
La clé de l'efficacité des mesures de confiance réside dans la qualité des procédures qui les sous-tendent. Les Nations unies fournissent des informations et des formations sur la mise en place et la gestion de processus fonctionnels pour des mesures de confiance efficaces.
Contact : conventionalarms-unoda@un.org
I. Mesures de communication et de coordination
- Échange d'informations
- Échangez des informations sur l'organisation militaire, notamment
- Le personnel
- Les principaux systèmes d'armes et d'équipements
- L'emplacement des unités
- Les changements significatifs dans la taille, l'équipement ou la mission des unités militaires.
- Échanger des informations sur les politiques, doctrines et tactiques pertinentes, les documents de politique de défense et les législations nationales.
- Échanger des informations sur les transferts d'armes, les stocks nationaux d'armes et les achats effectués par le biais de la production nationale.
- Échanger des informations sur les budgets et les dépenses militaires nationaux.
- Élaborer des méthodes communes pour mesurer les dépenses de défense.
- Échanger des informations sur les mesures de sûreté et de sécurité des munitions, y compris les systèmes de comptabilité.
- Échanger des calendriers d'activités militaires.
- Échanger des informations sur l'emplacement des installations nucléaires.
- Partager les renseignements militaires (y compris par satellite).
- Échanger des renseignements sur l'application de la loi.
- Accepter de soumettre des rapports nationaux aux traités et instruments internationaux et régionaux de désarmement et de contrôle des armements.
- Mettre en place une commission consultative mixte chargée de résoudre les différends relatifs à l'interprétation des données.
- Échanger des informations sur la présence de contingents militaires étrangers sur le territoire de l'État.
- Communication
- Établir un système de communication directe, ou "hotline", entre les chefs d'État, les ministres de la défense, les chefs des forces militaires et/ou les commandants militaires.
- Limitez l'utilisation de messages codés dans les communications.
- Désignez des points de contact militaires/défense.
- Mouvements de troupes, exercices et gestion des armes
- Notifiez à l'avance les exercices militaires, les essais de missiles, les mouvements de troupes et les activités.
- Notifiez à l'avance les activités navales en dehors des zones régulièrement couvertes.
- Notifier à l'avance ou convenir d'un mécanisme d'approbation des opérations aériennes et des vols à proximité des zones sensibles et frontalières.
- Convenir de procédures pour traiter les intrusions et incidents aériens ou terrestres accidentels en mer.
- Convenir d'utiliser des normes et des lignes directrices élaborées au niveau international pour la gestion des armes et des munitions.
- Notifier la réduction et l'élimination des armes et des munitions.
- Échange et convocation de personnel
- Échanger des attachés militaires et des officiers de liaison.
- Organiser des réunions régulières de responsables militaires afin d'échanger des informations et de discuter de questions et de préoccupations opérationnelles communes.
- Organisez des réunions de femmes officiers de police et militaires pour créer des réseaux, échanger des connaissances et partager des informations.
- Organisez des échanges et des visites entre le personnel de combat.
- Échanger du personnel militaire en tant qu'étudiant ou instructeur dans les académies militaires, les écoles militaires et les écoles de guerre.
- Convenir de visites réciproques de la flotte navale dans les ports et les bases navales.
- Organiser des activités sportives et culturelles communes et d'autres événements sociaux pour le personnel militaire.
- Inviter des fonctionnaires étrangers à assister et/ou inviter des troupes étrangères à participer à des défilés militaires nationaux et à des manifestations culturelles et sportives des forces armées.
- Établir des contacts et une collaboration dans le domaine de la recherche militaire.
II. Mesures d'observation et de vérification
- Accepter d'échanger des invitations à observer des manœuvres, des exercices et des entraînements militaires.
- Accepter d'inviter un tiers à observer des manœuvres, exercices et entraînements militaires.
- Accepter d'échanger des invitations à observer des démonstrations de nouveaux systèmes d'armes.
- Accepter d'autoriser des missions de vérification des informations fournies concernant les forces et les équipements militaires.
- Désigner une tierce partie pour surveiller et vérifier la mise en œuvre des accords de maîtrise des armements/désarmement et la destruction des armes.
- Convenir d'une surveillance conjointe des zones démilitarisées et des autres zones.
- S'entendre sur la surveillance par une tierce partie des zones démilitarisées et autres.
- Convenir de vols de surveillance aérienne au-dessus du territoire de l'autre partie.
- Permettre l'observation aérienne par des observateurs internationaux.
III. Mesures de contraintes militaires
- Mouvements de troupes, exercices, armes
- Limiter le nombre et la portée des exercices militaires majeurs.
- S'abstenir d'organiser des exercices aériens et maritimes sur les routes aériennes et maritimes convenues
- Limiter le type d'armes utilisées.
- Limiter le nombre d'armes utilisées.
- Limiter les mouvements de troupes.
- Restreindre l'emplacement / le placement des troupes.
- Restreindre l'emplacement / le placement des armes lourdes.
- Limiter les mobilisations et l'appel aux forces de réserve.
- S'abstenir d'organiser des exercices militaires à des dates sensibles dans le pays voisin (p. ex. période électorale, fête nationale).
- Interdire les exercices de tir réel.
- Couvrir les canons des pièces d'artillerie et des navires.
- Réduire la taille des troupes déployées à proximité de la région sensible.
- Mettre les troupes en état d'alerte.
- Mettre les systèmes d'armes en état d'alerte.
- Accepter de ne pas attaquer les installations nucléaires.
- Se mettre d'accord sur les activités militaires acceptables et inacceptables, en particulier dans les zones sensibles et frontalières.
- Zones frontalières / zones démilitarisées
- Mettre en place des capteurs pour compléter les patrouilles à pied et les postes d'observation. S'abstenir d'établir de nouveaux postes militaires ou des fortifications militaires le long des frontières.
- Établir une zone démilitarisée, une zone de sécurité ou une zone tampon des Nations unies.
- Élargir la zone démilitarisée ou créer une zone de déploiement limité au-delà de la zone démilitarisée.
- Élaborer un code de conduite pour les activités menées dans la zone démilitarisée ou dans une autre zone.
- Retirer les installations militaires et les fortifications de la zone démilitarisée.
- Retirer les mines terrestres de la zone démilitarisée.
- Retirer les postes de garde de la zone démilitarisée.
- Désarmer le personnel militaire dans la zone démilitarisée.
- Limiter le personnel dans la zone démilitarisée.
- Convenir de garanties pour la sécurité des chercheurs et des travailleurs opérant dans les zones démilitarisées - créer des sanctuaires pour la faune et la flore.
- Entreprendre une cartographie conjointe de la zone démilitarisée.
IV. Mesures de formation et d'éducation
- Enseigner les approches CBM dans les académies militaires, les écoles d'état-major et les écoles de guerre.
- Discuter des programmes de formation militaire.
- Échanger du personnel militaire en tant qu'étudiants dans les académies militaires, les écoles militaires et les écoles de guerre.
- Échanger du personnel militaire en tant qu'instructeur dans les académies militaires, les écoles militaires et les écoles de guerre.
- Appliquer les techniques de gestion des crises dans les postes de commandement et les exercices sur le terrain. Créer un centre de formation bilatéral/régional pour les questions de sécurité communes, y compris le maintien de la paix et la mise en œuvre des mesures de confiance.
- Organiser des formations conjointes/régionales pour les femmes officiers sur des questions de sécurité communes, telles que le maintien de la paix ou les mesures de confiance militaires.
- Encourager les instituts nationaux de recherche étrangère et militaire à accueillir des chercheurs invités de l'étranger pour étudier et contribuer à des sujets liés aux questions de sécurité régionale du pays hôte.
- Accueillir ou soutenir des réunions bilatérales et régionales pour discuter des mesures de confiance militaires.
- Organiser des ateliers de négociation, de médiation et de facilitation.
V. Mesures de coopération et d'intégration
- S'engager à respecter systématiquement les régimes et traités de maîtrise des armements et de désarmement.
- Mettre en place des unités conjointes de maintien de la paix.
- Organiser des exercices militaires conjoints.
- Mener des exercices conjoints de cartographie, y compris maritime.
- Mener des missions conjointes de recherche et de sauvetage en cas d'accident d'avion ou de bateau.
- Coopérer en matière de secours et de prévention des catastrophes et de suivi des ouragans.
- Mener des opérations conjointes d'élimination des mines terrestres et des restes explosifs de guerre le long de la frontière.
- Coopérer en matière de déminage en mer.
- Coopérer aux enquêtes sur les accidents liés aux munitions, tels que les explosions dans les zones de stockage, y compris en ce qui concerne la méthodologie.
- Établir des patrouilles frontalières et/ou des postes d'observation conjoints ou coordonnés le long des frontières (frontières verte et bleue)
- Créer des comités frontaliers conjoints.
- Établir une coopération entre les agences douanières et frontalières pour lutter contre le commerce transfrontalier illicite, par exemple les contrebandes, la traite des êtres humains, les armes légères et les stupéfiants.
- Élaborer un code de conduite commun pour le personnel frontalier, en particulier dans les zones frontalières contestées.
- Dans le cadre de missions et d'opérations conjointes, s'engager à garantir le déploiement d'officiers féminins.
- Élaborer des procédures communes pour traiter avec les personnes vivant dans les zones frontalières périphériques, y compris les nomades.
- Mettre en place un groupe de travail sur le traitement du passé.
- Créer des centres communs de gestion des crises et de prévention des conflits.
- Établir des centres/programmes conjoints de recherche militaire et/ou scientifique et technologique.
- Étudier les initiatives conjointes en matière d'acquisition et de maintenance.
Mesures de confiance pratiques dans le domaine des armes conventionnelles
En 2017, la Commission du désarmement des Nations unies a adopté des recommandations consensuelles à transmettre à l'Assemblée générale sur les mesures de confiance concrètes dans le domaine des armes classiques(A/72/42).
Les mesures de confiance pratiques recommandées par la session de 2017 soulignent l'importance des mesures de désarmement pour le maintien et le renforcement de la paix et de la sécurité régionales et internationales. Les recommandations reconnaissent les avantages des mesures de confiance, notamment pour désamorcer les tensions, promouvoir la coopération entre les États, renforcer le dialogue et une plus grande transparence, et promouvoir les progrès en matière de désarmement conventionnel et de maîtrise des armements. La Commission recommande aux États d'envisager des mesures telles que l'échange périodique d'informations et de notifications, le renforcement de la coopération, notamment par le biais de l'assistance financière et technique, et le soutien aux séminaires et ateliers qui favorisent la transparence, le dialogue et la sensibilisation.
Instruments de transparence
Créé en 1981, le rapport des Nations unies sur les dépenses militaires (MilEx) permet aux États de partager des informations sur leurs dépenses militaires annuelles. Le rapport vise à accroître la transparence, à renforcer la confiance et, en fin de compte, à faciliter la réduction des dépenses militaires.
En 1991, l'Assemblée générale a créé le Registre des Nations unies sur les armes conventionnelles (UNROCA), qui permet aux États de communiquer aux Nations unies leurs importations et exportations d'armes et de contribuer ainsi à déterminer s'il existe des accumulations d'armes excessives ou déstabilisantes. Cette transparence en matière d'armement peut encourager la retenue et contribuer à l'alerte précoce et à la diplomatie préventive.